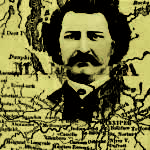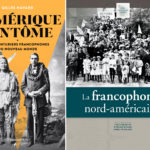La plus ancienne compagnie canadienne est au bord du gouffre. De la traite des fourrures au commerce de détail, la Compagnie de la Baie d’Hudson est un élément emblématique du Canada, avant même la création du pays. D’ici peu, il pourrait n’en rester que des miettes. Ou encore rien du tout.
La Compagnie de la Baie d’Hudson doit son existence en bonne partie à deux aventuriers français: Médard Chouart Des Groseillers et Pierre-Esprit Radisson.
En 1658 ou 1659, les deux hommes partent pour les Grands Lacs et reviennent à Québec avec une petite fortune en peaux de castor. Mais les autorités confisquent les fourrures, car la traite des pelleteries dans cette région a été interdite.
Le prince Rupert
Déçus que leur projet de commerce de fourrures avec la France ait échoué et incapables de convaincre les autorités françaises d’exploiter le territoire des Grands Lacs, Des Groseillers et Radisson se rendent à Londres.
Le prince Rupert, cousin de Charles II, s’intéresse à leurs démarches. Il arrive à convaincre le roi et des marchands anglais.