
Premier jour de «retrait» du Règlement 17
Le 1er novembre 1927 marque un tournant dans l’éducation en langue française dans la province de l’Ontario. Ce jour-là, le célèbre Règlement 17 devient officiellement inoffensif. Le français acquiert un statut valide et juridique dans les écoles primaires, des écoles secondaires bilingues sont créées, des inspecteurs canadiens-français surveillent les instituteurs francophones et une école normale est créée à l’Université d’Ottawa. Le Règlement 17 avait été imposé en 1912 par le gouvernement conservateur de James Pliny Whitney. Il limitait l’enseignement en français aux deux premières années du cours primaire et n’autorisait pas plus qu’une heure d’enseignement du français dans les autres […]

Première statue d’une héroïne canadienne
La première statue d’une Canadienne commémore l’acte héroïque que Madeleine Jarret a accompli le 22 octobre 1692 en défendant le fort de Verchères. Ce n’est que 220 ans plus tard qu’une statue du sculpteur Louis-Philippe Hébert immortalisera l’exploit de Madeleine de Verchères. Inauguré le 21 septembre 1913, le monument se dresse fièrement sur la rive du Saint-Laurent à Verchères. Madeleine Jarret naquit sur la seigneurie de son père en 1678. Le seigneur de Verchères prenait part aux manœuvres militaires, mais gérait aussi son domaine, ses bêtes et ses cultures comme la plupart des Français installés en Nouvelle-France à cette époque. […]
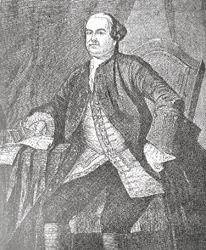
Le premier siège de Québec
«Nous les saluâmes les premiers et ensuite, ils commencèrent leurs canonnades assez vigoureusement.» C’est ainsi que Charles de Monseignat, secrétaire du comte de Frontenac, narre les premières minutes du siège de Québec par l’amiral William Phipps, le lundi 16 octobre 1690. Phipps avait envoyé un émissaire pour sommer Frontenac de se rendre. Ce dernier a répondu avec morgue et panache: «Je n’ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil.» La bataille va durer une semaine. La réponse de Frontenac fut plus significative qu’on eût pu le souhaiter. […]

Élection du premier conseil municipal
Le dimanche 7 octobre 1663, après la grand-messe, se tenait à Québec une assemblée publique convoquée par le gouverneur d’Avaugour pour procéder à «l’élection d’un maire et de deux échevins qui auront le soin des affaires publiques de la ville et de son ressort». Jean-Baptiste Le Gardeur de Repentigny fut élu maire; Jean Madry et Claude Charron furent nommés échevins. C’est le premier conseil municipal mentionné dans nos annales. Fils de Pierre Le Gardeur de Repentigny et de Marie Favery, Jean-Baptiste fut baptisé vers 1631. Le 11 juillet 1656, à Québec, il épousa Marguerite Nicolet, fille de Jean Nicolet de […]

Premières femmes admises à l’Université de Toronto
C’est le 1er octobre 1884 que les femmes sont entièrement admises à l’Université de Toronto. Avant cette date, elles pouvaient tout au plus roder dans les coulisses de la célèbre institution. Le King’s College, précurseur de l’Université de Toronto, reçoit ses premiers étudiants en 1843 mais ses portes restent fermées aux étudiantes jusqu’en 1884. En 1877, on permit aux femmes de passer des examens d’entrée à l’Université de Toronto, mais on leur interdisait, paradoxalement, d’assister aux cours! Elles pouvaient aussi passer les examens de fin d’année… si elles pouvaient se payer des tuteurs. En 1881, les femmes purent commencer à […]

Première station de radio française en Amérique
Dans toute l’Amérique du Nord, la station radiophonique CKAC, du journal La Presse, fut la première de langue française. Elle entra en ondes le 27 septembre 1922. À ses débuts, CKAC partageait l’antenne de CFCF et fut bilingue pendant une dizaine d’années. En 1922, partout dans le monde on parlait des merveilles du sans-fil. La Presse annonça à ses lecteurs qu’ils pourraient bientôt «être en communication constante avec le poste CKAC» que le quotidien décida d’aménager à l’étage supérieur de son immeuble principal, dans le quartier des affaires. Le journal invita ses lecteurs à se procurer un appareil récepteur et […]

Premier journal français de la Colombie-Britannique
L’année 1858 voit la création de trois journaux en Colombie-Britannique. Il y a d’abord la Victoria Gazette qui est lancée le 25 juin, puis la Vancouver Island Gazette un mois plus tard. Le premier journal de langue française voit le jour le 18 septembre 1858. Il s’agit du Courrier de la Nouvelle-Calédonie. Si le journal porte ce nom, c’est parce que la Colombie-Britannique fut d’abord appelée Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce que plusieurs employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson établis sur la côte du Pacifique étaient des Écossais de la région située au-dessus des estuaires des fleuves Clyde et Forth, […]

Le premier Blanc sur le site actuel de Toronto
Vivant vraisemblablement en Huronie depuis 1610, Étienne Brûlé participe, à l’été 1615, à une mission qui le mène au pays des Andastes, dans le comté actuel de Tioga (État de New York). Le trajet suivi semble être celui de la rivière Humber jusqu’à son embouchure, soit le site actuel de Toronto. Brûlé y aurait séjourné le 9 septembre 1615 et serait donc le premier Blanc à avoir vu le futur emplacement de Toronto. Étienne Brûlé était un aventurier français né vers 1592, à Champigny-sur-Marne, à l’est de Paris. Parti très jeune pour la Nouvelle-France, sans doute dès 1608, il fut […]

Le premier vin de Porto remonterait à 1650
La querelle qui opposa la France à l’Angleterre au XVIIe siècle fit paradoxalement le bonheur du vin de Porto. Face aux difficultés d’approvisionnement en vins de Bordeaux, les courtiers anglais furent contraints en effet de se tourner vers de nouveaux marchés. Grand producteur de vin, le Portugal exporte déjà sa production vers l’Angleterre, mais ce n’est qu’à partir de 1650 que le porto va se développer. Des compagnies anglaises s’établissent alors au Portugal. Le «vin de Porto», tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’existe pas encore. La légende veut qu’un moine de l’abbaye de Lamego eût un jour l’idée d’enrichir […]

Le premier vin de glace remonterait à 1794
Probablement découvert par hasard dans la région de Franconie, en Allemagne, le vin de glace apparaît pour la première fois en 1794, à la suite d’un hiver particulièrement rigoureux. Dès la première moitié du XIXe siècle, les vignerons allemands et autrichiens commencent à en produire de façon régulière. Les œnologues sont agréablement surpris par la richesse aromatique et l’onctuosité de ce vin. Tant et si bien que de nombreuses autres régions du monde se sont prises de passion pour ce nectar liquoreux et hors de prix. La Nouvelle-Zélande et le Canada figurent en tête. Le Canada commercialise son premier vin […]
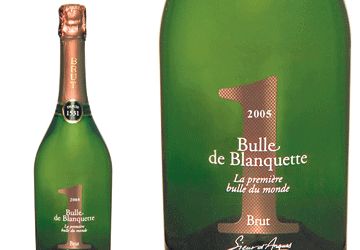
Le premier vin mousseux remonterait à 1531
L’Église a grandement contribué au développement de la viticulture française. Ingénieux, les moines furent longtemps les premiers «inventeurs» du vin. Dès 1531, soit 150 ans avant la naissance du champagne, les moins bénédictins de l’abbaye de Saint-Hilaire connaissaient l’art de transformer les vins tranquilles en vins effervescents. Cette découverte est probablement fortuite, mais les vignerons de Limoux vont la perfectionner au fil des ans. Les premières blanquettes seront commercialisées dès 1544 et leur élaboration obéit, aujourd’hui encore, à un rituel complexe, méthodique et rigoureux. Les premiers jus obtenus par pressage sont recueillis pour former les têtes de cuvées et serviront […]

La première étiquette de vin remonte à 1350 avant J.-C.
Les Égyptiens, dit-on, sont les champions de la bureaucratie. Ils confiaient à leurs scribes toute la gestion administrative, juridique et comptable de l’État. Procéduriers jusqu’à l’extrême et remarquablement précis, rien n’échappait à leur vigilance. Il n’est donc pas surprenant que, les premiers, les Égyptiens aient songé à étiqueter le vin. À cet égard, la sépulture de Toutankhamon recèle une mine impressionnante de renseignements. Plus de cinquante amphores intactes y ont été retrouvées, dont au moins une trentaine contenant du vin. Vingt-six d’entre elles font apparaître une cartouche indiquant le millésime, la nature du vin, sa provenance, le nom du propriétaire […]



