Outre l’humour, les mèmes jouent aussi un rôle identitaire. Selon certains chercheurs, ils contribuent à faire vivre la langue, la culture, la solidarité et le sentiment d’appartenance au sein des communautés francophones. Mais comment?
Les mèmes – ces images, vidéos ou textes largement remixés sur Internet – constituent un espace unique où l’humour nourrit la vitalité linguistique et culturelle, comme le montrent des recherches menées par des experts francophones sur ce sujet.
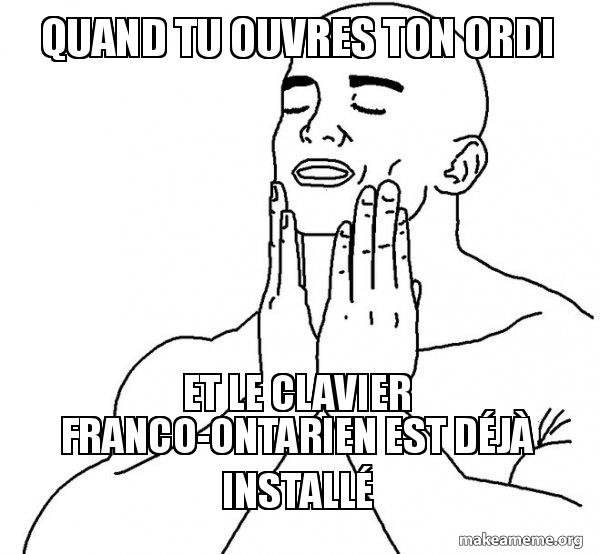
«Le jeu des mèmes est de prendre quelque chose d’universel et de le rendre “très spécifique” à une certaine communauté ou un individu, en l’appropriant», explique Nathan Rabalais, professeur en études francophones à l’Université de Louisiane, à Lafayette. Il précise que la modification du contexte se fait plus au niveau du texte, alors que l’image reste la même.
Les mèmes, c’est quoi?
Les mèmes correspondent à des «iconotextes», c’est-à-dire des «amalgames de textes et d’images, qu’on peut modifier, partager et commenter», décrit le professeur Stéphane Girard de l’Université de Hearst.

Nés durant la deuxième moitié du 20e siècle, l’idée du mème précède Internet. Elle a été conçue par Richard Dawkins dans son œuvre Le Gène égoïste, pour désigner des éléments culturels qui circulent par imitation, qui évoluent comme des gènes.
















