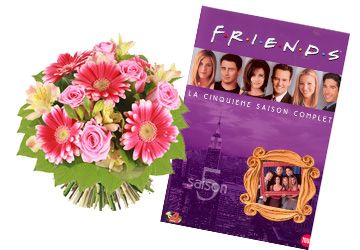Pour le journaliste ontarien Graham Fraser, apprendre le français a été l’expérience de sa vie et vivre au Québec pendant une décennie a été un des hauts faits de sa vie professionnelle. Aujourd’hui correspondant national du Toronto Star à Ottawa, Fraser a couvert la politique à Toronto, Montréal, Québec et Washington. Il vient de publier un brillant essai intitulé Sorry, I Don’t Speak French: Confronting the Canadian Crisis That Won’t Go Away. Cette analyse pose un regard critique sur ce qu’on pourrait appeler «le nœud de la question canadienne».
Il ne s’agit pas d’un livre sur le Québec, la Constitution ou les luttes des minorités de langue officielle.
L’approche de Fraser demeure plus modeste. Il examine les «pressions» qui ont conduit à la création de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, puis à l’adoption de la Loi sur les langues officielles.
Il dissèque l’impact des politiques linguistiques sur Montréal et Ottawa. Il analyse ce qui a changé (ou non) dans notre système d’éducation.
L’auteur commence par un petit cours d’histoire, précisant que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867) a uni un nouveau pays tout en séparant ses composantes (Canada-Ouest et Canada-Est) et donnant des pouvoirs politiques spéciaux au Québec.