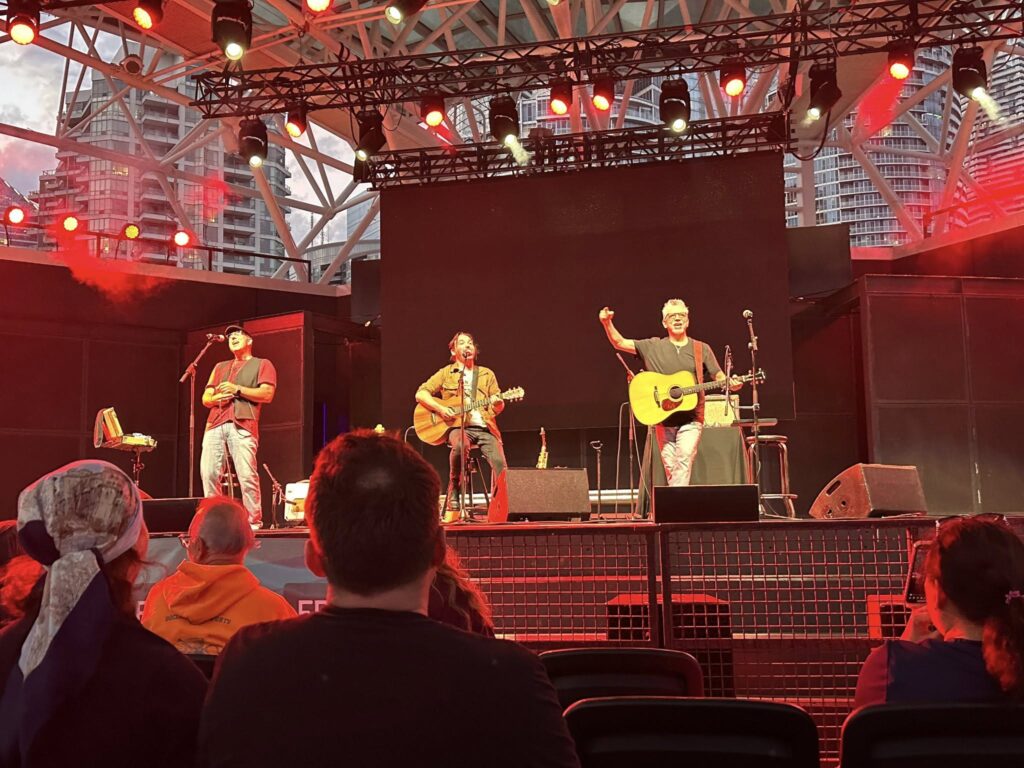La francophonie canadienne évolue à vitesse grand V, tout comme ses artistes et sa musique. Lors d’une journée organisée par l’Adisq, le 26 septembre, à Montréal, des acteurs et des actrices du milieu ont discuté du lien étroit et pourtant si mouvant qui unit identité et chanson francophone.
«C’est quoi l’identité francophone en Ontario quand le recensement de 2021 te dit que les sept principaux pays d’immigration francophone sont en Afrique? Cette démographie-là, elle change», a d’emblée lâché l’artiste franco-ontarien Yao, lors d’une discussion dans le cadre de l’évènement organisé par l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (Adisq).
«Quand l’ONU est capable de te dire que Paris n’est plus la première ville française au monde, qu’il y a plus de locuteurs francophones à Kinshasa au Congo qu’il y en a à Paris, et que d’ici 2050, près de 90% de la francophonie jeunesse sera sur le continent africain, on a besoin de se questionner.»
Quelle identité francophone canadienne?
Pour lui, il est nécessaire d’avoir une réflexion sur l’identité francophone canadienne – et donc par ricochet sur la culture qui l’entoure –, surtout en ce moment, alors que la francophonie change «à vue d’œil».

Mais qui est en position de dire ce qui est francophone et ce qui ne l’est pas? «C’est pas nécessairement juste des individus, ce sont des institutions», observe Anne Robineau, directrice adjointe de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, au Nouveau-Brunswick.