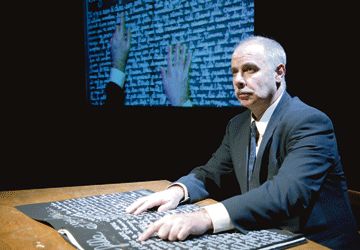Les fenêtres givrées du YMCA de l’avenue du Parc à Montréal, le code de conduite d’Hérouxville, les demandes de séparation des sexes dans les cours prénataux, l’interdiction de porter le hidjab dans un tournoi de soccer, autant d’incidents qui ont déclenché toutes sortes d’opinions sur les accommodements raisonnables. Pour placer ce débat dans un contexte qui tient compte à la fois des libertés individuelles et des droits collectifs, Yolande Geadah a publié un court essai intitulé Accommodements raisonnables: droits à la différence et non différence des droits.
D’origine égyptienne, Yolande Geadah vit au Québec depuis quarante ans. Œuvrant dans le domaine du développement international et des relations interculturelles, elle est aussi l’auteure de Femmes voilées, intégrismes démasqués. Elle estime que «la montée des intégrismes religieux menace non seulement les femmes mais l’ensemble de la société».
C’est en 1985 que la notion d’accommodement raisonnable fait son apparition dans le droit canadien. La cause concerne une vendeuse ontarienne dans un magasin Sears, qui refuse de travailler le samedi parce que cela est contraire aux préceptes de sa religion. Son employeur la relègue au statut d’employée occasionnelle. La plaignante conteste cette décision, alléguant qu’il s’agit d’un acte de discrimination fondée sur la religion. La Cour suprême lui donne raison.
Dix ans plus tard, à Calgary, un agent de la Gendarmerie royale du Canada exige de porter le turban au lieu du traditionnel chapeau de la police montée. La Cour d’appel fédérale lui donne raison en concluant qu’il n’y a pas, constitutionnellement, d’empêchement au port du turban sikh dans cette force policière.
Selon l’auteure, certains Canadiens commencent à trouver que le concept juridique d’accommodement raisonnable donne de plus en plus lieu à une multiplication de revendications religieuses, voire à des interprétations abusives dudit concept.