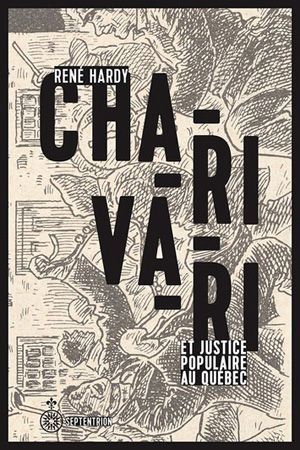Historien de la culture populaire, René Hardy s’est penché sur le charivari, un phénomène maintenant disparu du Québec, mais dont l’histoire regorge de facettes intéressantes. Son essai intitulé Charivari et justice populaire au Québec lève le voile sur un mécanisme efficace de contestation bruyante, qui n’est pas sans rappeler «le printemps érable».
Réduit à sa plus simple expression, le mot charivari peut se résumer à «contestation / réprobation / jugement punitif». De façon plus explicite, René Hardy parle d’«action de groupes relativement considérables exerçant sous une forme plus ou moins ritualisée leurs actions punitives contre un ou des individus qui ont enfreint un code de conduite implicite accepté par une partie importante de la population locale».
L’auteur note que c’est vers 1310 que le terme charivari est mentionné pour la première fois en France, par Gervais du Bus, auteur du Roman de Fauvel. Comme le charivari consiste à faire du bruit pour dénoncer une situation, le plus souvent une entorse au code matrimonial, les folkloristes se demandent si le mot vient du grec chalibarion (bruit obtenu en frappant sur des vases d’airain ou de fer).
Des mots semblables existent aussi en Allemagne (polterabend), aux Pays-Bas (ketelmuziek), en Italie (scampanata) et en Angleterre (rough music). En Europe, le charivari se présente comme «un rassemblement de personnes, masquées ou non, qui a souvent lieu la nuit dans le but de faire, en face de la maison des chavirés, une musique dérisoire, des sérénades moqueuses […] et un vacarme discordant… Ce rituel se fait à répétition pendant des jours, voire des semaines.»
Ces vacarmes discordants visent ceux et celles qui transgressent les rôles conjugaux, les remariages mal assortis de veufs et de veuves, «l’adultère, le séducteur (généralement marié) de jeunes femmes, l’homosexuel ou tout autre comportement considéré comme pervers, la violence physique contre l’épouse ou la cruauté envers les enfants».