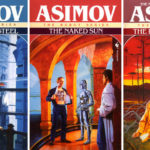Phyllis Dorothy James, qui signe P.D. James, a inventé une dix-septième enquête policière en campant des personnages dans un cadre pittoresque et en les plongeant dans une intrigue qui les ramène constamment à leur passé douteux. La psychologie occupe une place de choix dans Une mort esthétique, tout comme les réflexions sur la structure sociale britannique, la nature humaine et, surtout, la limite floue entre culpabilité et innocence.
Quand la célèbre journaliste d’investigation Rhoda Gradwyn est admise dans la clinique privée du docteur Chandler-Powell pour faire disparaître une cicatrice qui la défigure depuis l’enfance, elle a en perspective une opération réalisée par un chirurgien reconnu, une paisible semaine de convalescence dans l’un des plus beaux manoirs du Dorset et le début d’une nouvelle vie. Pourtant, malgré le succès de l’intervention, elle ne quittera pas Cheverell Manor vivante. Le commandant Dalgliesh et son équipe, appelés pour enquêter sur ce qui se révèle être un meurtre suivi d’une deuxième mort suspecte, se trouvent confrontés à des problèmes qui les conduiront bien au-delà de la simple recherche des coupables.
Comme c’est souvent le cas, la mort attire des spectateurs innocents. Captivés par un homicide, ces êtres sont obnubilés par le lieu du crime et dévorés par une fascination incrédule. «Les ragots et les rumeurs ne se nourrissent pas de vérité.»
Dès la première page, on sait qu’une femme va mourir mais le meurtre n’a lieu qu’à la page 120. Ce roman de 456 pages est découpé en 56 chapitres assez courts. La narration, elle, n’est pas succincte, loin de là.
Les détails inutiles abondent, les descriptions fastidieuses sont courantes et les détours languissants pullulent. À titre d’exemple, la romancière prend trois pages pour décrire une pièce lambrissée de chêne, une bibliothèque élégamment sculptée et un petit balcon en fer forgé. À la longue, on s’ennuie.