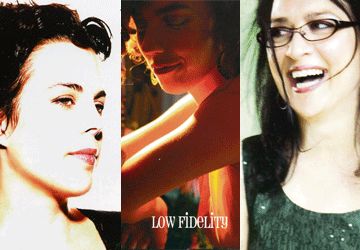Plusieurs critiques se sont étonnés lorsque Roxanne Potvin a choisi de s’éloigner des stricts paramètres du blues (les 12 mesures, les inévitables – et souvent ennuyeux – solos de guitare) pour nous pondre No Love For The Poisonous (Disques Alert). Pourtant, les ingrédients de ce troisième album étaient déjà présents dans son précédent opus, The Way It Feels, où la jeune artiste originaire de Gatineau – mais désormais torontoise – faisait preuve d’une impressionnante maîtrise d’une foule d’idiomes américains (r&b néo-orléanais, blues de Chicago, country), ce qui pouvait étonner, de la part d’une artiste aussi jeune.
Ce qui a changé, avec ce nouveau disque réalisé avec beaucoup de sensibilité par Dave Mackinnon, réside plus au niveau du fond que de la forme. En effet, No Love For The Poisonous («pas d’amour pour les vénéneux») s’écoute comme un compte-rendu de ce que Roxanne a vécu et appris depuis le virage de l’âge adulte, un document douloureusement honnête des angoisses existentielles qui s’emparent d’une jeune femme qui cherche sa voix – et sa voie – tant sur le plan professionnel que personnel.
Ceux qui côtoient Potvin ou qui l’ont vue sur scène ont pu témoigner de sa vulnérabilité (c’est presque à contre-cœur qu’elle affronte les projecteurs), mais cette fois, elle confronte ses démons par le biais de l’écriture («I can’t move, I can’t breathe/I’m scared of my own fears»). Et c’est lorsqu’elle se permet de douter d’elle-même et d’autrui que Roxanne nous offre ses perspectives les plus probantes. C’est ainsi que les tergiversations de Je t’aime, la seule chanson française de l’album, sont communiquées dans un langage d’une désarmante simplicité, pour rendre compte des angoisses qui étreignent une jeune femme face à une relation qui pourrait n’être qu’une aventure.
Malgré leurs occasionnelles maladresses, les chansons qui composent No Love For The Poisonous ont le mérite de jouer la carte de l’introspection sans tomber dans l’apitoiement. Parions que de nombreuses personnes qui prendront le temps d’écouter ce témoignage honnête y trouveront un écho de leurs propres tiraillements intérieurs.
Une artiste convaincue, un disque convaincant
En constraste, on aurait du mal à déceler la moindre crise d’identité à l’écoute de Low Fidelity (Autoproduction), le second album de l’auteure-compositrice interprète Treasa Levasseur, qui a grandi à North Bay mais élu domicile, elle aussi, à Toronto, là où elle a fondé une famille musicale aussi vaste que variée. Ce n’est pas que Treasa n’a pas sa part de doutes, mais elle prend le parti d’affronter ses démons comme un boxeur affronte son adversaire : au centre du ring, et déterminée de ne pas céder un pouce. Dès que la section rythmique établit le groove irrésistible de Help Me Over, on comprend que l’on a affaire à une artiste en pleine possession de ses moyens et complètement heureuse de se mettre à nu par le biais de la musique. Il faut dire que Treasa possède la voix à l’appui de son attitude, une voix pétrie de soul classique, capable de rugir, de provoquer ou de séduire, selon les exigences du moment.