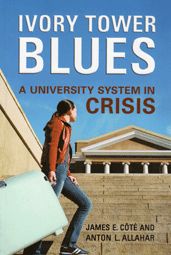Mes copines et moi sommes mères d’adolescents en 11e année. Pour les parents qui ne sont pas encore rendus là, ça veut dire qu’on se fait du mouron de façon concrète quant à l’avenir de nos grands depuis près d’un an. En principe, ils devraient être en mesure de choisir une carrière et d’envoyer leur candidature à l’université dans moins d’un an, mais en réalité, c’est autre chose. Toutes mes amies sont comme moi allées à l’université. Nous avons donc l’impression d’avoir des opinions informées sur le sujet, étant nous-mêmes passées par là. Mais sommes-nous réellement de bon conseil?
En préparant ma chronique du mois dernier sur les parents hélicoptères, je me suis demandé pourquoi ceux-ci semblaient si nerveux si tôt quant à l’avenir de leurs jeunes enfants. Mes propres parents n’avaient jamais manifesté de doutes sur mon acceptation éventuelle à l’université (à cinq ans, j’affirmais à qui voulait l’entendre que j’irais à l’université). Étaient-ils plus naïfs? Est-ce que l’université est réellement plus inaccessible qu’avant?
En lisant sur ces hyper-parents qui contestent les B de leurs enfants à l’élémentaire, je me rappelais mon étonnement en voyant les notes sur les bulletins de mes enfants. Les moyennes dans la majorité des cours me semblaient beaucoup plus élevées que «dans mon temps». Les travaux écrits pour lesquels mes enfants recevaient (parfois) des A me semblaient de moins bonne qualité que ce que je produisais à leur âge. Est-ce que ma mémoire me jouait des tours?
Puis, j’apprends que la note moyenne d’admission pour plusieurs départements dans différentes universités canadiennes est autour de 85%! Eh bien là, je ne comprends plus.
Le Blues des universités
La majorité des étudiants que je connais n’ont pas ces moyennes. Plein de parents autour de moi payent des tuteurs pour aider leurs enfants à augmenter leurs notes plus faibles dans certaines matières. De façon générale (il y a toujours des exceptions) je ne connais pas de jeunes faisant preuve d’un grand entrain pour l’école secondaire (mis à part pour les activités para-scolaires et les cours où ils peuvent se lancer dans le multi-média). Mais où donc sont tous ces étudiants performants qui foncent bille en tête vers l’université et qui font monter les enchères des notes d’admission? Et surtout, si c’est ça «la game», quelles seront les options pour nos grands?