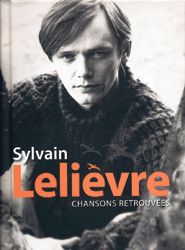J’ai mis un certain temps à arriver à Sylvain Lelièvre. Pourquoi? Il n’y a, a priori, rien de rebutant dans l’œuvre de l’auteur-compositeur qui nous a quittés un 30 avril 2002, à 59 ans à peine, alors qu’il revenait des Îles-de-la-Madeleine, où il venait d’offrir un atelier d’écriture, ce qui constituait sa passion et même sa vocation.
J’aurais dû m’intéresser à lui plus tôt, ne serait-ce que pour des raisons sentimentales: en effet, Lelièvre est né à Limoilou, le même quartier de la basse-ville de Québec où mon père avait vu le jour une quinzaine d’années plus tôt.
Mais à l’époque où, gamin, je découvrais «cette Amérique qui chante en français», d’abord par le biais de Beau Dommage (dont j’écoutais les deux premiers microsillons en cachette, puisqu’ils appartenaient à mon frère et ma soeur aînés, et que je n’avais pas encore le droit de toucher au «système de son» familial), l’auteur de Marie-Hélène ne figurait pas au programme.
Même chez mes cousins de Shawinigan, qui étaient plus âgés et savaient donc tout, on ne jurait que par Plume ou Aut’Chose, pourvoyeurs de frissons autrement plus corsés.
Et puis voilà que depuis quelques années, je suis prêt à recevoir ce que Sylvain Lelièvre avait à offrir: des chansons qui ne font jamais dans l’esbroufe ni dans la démagogie fleurdelysée, et qui sont d’autant plus émouvantes qu’elles refusent de tirer les grosses ficelles de l’émotion. Lelièvre, c’est un peu le frère dont j’aurais découvert l’existence sur le tard, et dont la voix venait me chercher au seuil d’une quarantaine plus ou moins sereinement assumée.